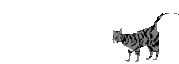-
Compteur de contenus
141 -
Inscription
-
Dernière visite
Type de contenu
Forums
Blogs
Boutique
Calendrier
Téléchargements
Galerie
Articles animaux
Sites
Annuaire animalier
Petites annonces
Tout ce qui a été posté par Liliblue35
-

Déroulement d'une ovariectomie (images)
Liliblue35 a répondu à un(e) sujet de Liliblue35 dans Chats et reproduction
Intubation et intervention : L'intubation : Après avoir intubé la chatte, on branche un moniteur extérieur qui détectera un éventuel arrêt respiratoire. Le tube que l'on voit ci-dessus est introduit dans la trachée. Le respirateur Même si la vision du chat attaché est impressionnante, il faut noter que la position qu'on lui a fait adopter (les pattes croisées sur la poitrine) permet une respiration sans effort contrairement à la position pattes de devant écartées. On note bien la présence du tuyau de respiration introduit dans la gueule du chat. L'incision : La première étape est le placement de champs stérile autour de la zone qui va être opérée. Ensuite, on commence l'incision de l'abdomen de la femelle. La réelle désinfection. Maintenant, on ne touche plus ! La zone est stérile. Les pinces servent à fixer le champ par rapport au corps du chat. Sources : Copyright Eurochats.com / Maehdros (c) 2004 http://www.eurochats.com/dossiers/2004-10/2.php Avec l'accord d'Eurochats. -

Déroulement d'une ovariectomie (images)
Liliblue35 a répondu à un(e) sujet de Liliblue35 dans Chats et reproduction
PENDANT : Toutes les photos ont été mise en miniatures (âmes très sensibles abstenez-vous quand même), mais vous pouvez cliquez dessus pour les voir en plus grandes ou aller directement sur le site : d'Eurochats. Merci de votre compréhension. Anesthésie et préparation : La stérilisation de la chatte est une opération pratiquée très couramment et qui est bien maîtrisée. Comme toute opération pratiquée dans l'abdomen, l'anesthésie et l'intubation constituent les premières étapes. On fait une injection anesthésiante à la chatte : Une fois endormie, elle est rasée sur le bas de l'abdomen et ensuite badigeonnée de produit désinfectant. Étant donné le fait que le corps du chat est entièrement recouvert de poils, il est pratiquement impossible d'obtenir un état d'asepsie totale sur la peau. On peut cependant raisonnablement considérer la zone à traiter comme correctement nettoyée. La désinfection réelle ne se fera que quelques instants avant d'appliquer le champ stérile. La femelle est prête à passer en salle d'opération. Sources : Copyright Eurochats.com / Maehdros (c) 2004 http://www.eurochats.com/dossiers/2004-10/index.php Avec l'accord d'Eurochats. -
AVANT : Si votre chatte n'a pas vu un vétérinaire depuis longtemps, ce serait bien de faire une visite post-opératoire, pour voir si tout va bien. Vous pouvez profitez de l'opération pour faire la pose d'une puce électronique (*) ce qui peut baisser le prix de ces deux interventions, si vous les réaliser séparément. Une fois votre rendez-vous pris (environ une semaine à l'avance), préparer le voyage pour limiter le stress. Laisser la boîte de transport en accès libre à votre minette. Ainsi, elle pourra la renifler, déposer ses phéromones ce qui permettra de diminuer considérablement l'angoisse de cette boîte inconnue lors du départ. Si elle est déjà monter dedans, peu régulièrement, et toujours pour aller chez le vétérinaire, faite de même en l'aspergeant au préalable de phéromones de synthèse (en vente en pharmacie vétérinaire, en animalerie et sur Internet). La veille, pensez à retirer la nourriture et l'eau de votre chatte. Celle-ci doit être a jeun pour l'opération. Calculer environ 12 heures de jeun avant celle-ci.
-

CHAT : la vaccination
Liliblue35 a répondu à un(e) sujet de Admin-lane dans Généralités sur les chats
La vaccination du chat intervient lorsqu’il n’est plus protégé par les anticorps de sa mère, c’est-à-dire vers deux mois. Le chat doit recevoir sa première injection à cet âge, et la seconde un mois plus tard. Ensuite, sachez qu’un rappel annuel est indispensable pour le protéger efficacement de nombreuses maladies. De plus, les défenses immunitaires du chat baissent avec l’âge. Ne négligez donc pas ses vaccins même s’il est vieux. -

Vous venez d'adopter un chaton (conseils)
Liliblue35 a répondu à un(e) sujet de Liliblue35 dans Tout sur le chat
Une adoption doit-être réfléchie. Tous les membres de la famille doivent être favorable à l'arrivée de ce nouveau membre à part entière. il suffit d'un membre contre pour que cette adoption se transforme en cauchemar au long terme et que ce chat finisse dans la rue. Avoir un chaton c'est aussi assurer son bien-être, le nourrir et l'abreuver ne suffit pas. Son bien-être dépend également des conditions de vie qui doivent correspondre à ses besoins naturels : > le sommeil > la chasse et/ou les jeux > le toilettage > la nourriture et l'eau > la litière (placé dans une autre pièce ou très loin de sa nourriture) Et aussi les soins médicaux : vaccinations, stérilisation, la puce électronique ou la tatouage, vermifuge et anti-puce, maladies... Tous ces paramètres sont a prendre en compte lors de l'adoption. Si vous n'êtes pas près à payer le vétérinaire quand votre chat en aura besoin, il vaut mieux prendre une peluche. Un chaton est si mignon ! Comment peut-on y résister ? Pensez aussi qu'un chaton grandit très vite. Il devient adulte à l'âge d'un an et peut vive jusqu'à 20 ans. Il restera avec vous tout ce temps ! Pas question de l'abandonner car il ne correspond plus à vos désirs. Un chat n'est pas un objet et possède des sentiments. Un chaton a besoin d'être éduqué. Il se peut qu'il s'attaque à votre tapisserie , vos meubles... Pour éviter un maximum ce type de risques, proposez-lui des endroits pour faire ces griffes. Il y en a de toutes sortes : arbres à chat (très pratique surtout si le chat ne peut pas sortir en extérieur), paillassons, griffoirs au sol, au mur de différentes formes, classique ou ludique, il y en a pour tous les goûts... Ne vous limitez pas à un griffoir dans une seule pièce, n'hésitez pas à les multiplier. Vous pouvez même les fabriquez vous-même en enroulant du sisal (cordage) sur un pied de table par exemple. Un chaton ne doit pas être adopté avant deux mois et demi, trois mois minimum car même si le sevrage est fait, il a besoin d'être éduqué par maman. Assurez-vous également qu'il a été assez manipulé pour être habitué à l'homme pour cela : avant l'adoption, allez le voir dans la famille où il est né. Vous verrez les conditions de vie qu'il a pu avoir avant d'arriver chez vous. Demandez avec quoi il a été nourrit, le type de litière utilisée pour ne pas changer ses habitudes du jour au lendemain. Profitez de se moment pour le manipuler gentillement. -
Quelques conseils afin de faciliter la venue de votre nouveau compagnon : Vous allez apprendre à vous connaître et à vous aimer. Avant d’accueillir un chaton, assurez-vous que votre maison ne recèle pas de dangers tels que des étagères mal fixées, un accès à des produits toxiques, des raccords électriques dangereux. Protégez les fenêtres et les rebords de balcons avec du grillage. Attention aux plantes que le chaton mordillera. Les espèces suivantes sont des poisons pour les chats : Philodendron, dieffenbachia, ficus, caoutchouc, lierre, laurier rose (une liste plus conséquente sera mise au point ultérieurement). L’ARRIVÉE : · De préférence, ne pas laisser au chaton tout l’espace, surtout quand vous êtes absent et ne pouvez le surveiller. · Dans les premiers temps, ne lui laisser l’accès qu’à une pièce puis petit à petit, sous votre contrôle, il apprendra le reste de l’appartement ou de la maison. · Ne pas le laisser sortir hors de l’habitation. PROPRETÉ : · Protéger la terre de vos plantes par des cailloux pour qu’il ne fasse pas dedans. Il y a de fortes chances pour que le chaton soit déjà propre. Présentez-lui son bac dès l’arrivée, avec douceur. Deux ou trois gouttes d’ammoniaque au fond du bac devraient faire l’affaire pour l’attirer. . Changer la litière tous les jours. Dans une grande maison, mettre deux bacs à sa disposition. ENTRETIEN : · Habituez-le au griffoir en l’y menant chaque fois que vous le voyez faire. Habituez-le, de même, en lui coupant le bout des griffes : cela se fait quand il est sur vos genoux, à moitié assoupi, en lui pressant doucement le bout des pattes pour faire sortir les griffes et en ne coupant que la pointe blanche. · Brossez-le tous les jours. · Nettoyez ses oreilles avec douceur. · Manipulez-le le plus possible. · Avec de la patience, votre chaton deviendra un chat bien élevé. NOURRITURE : · Les chats se nourrissent plusieurs fois par jour. Pour les chatons de moins de 2 mois, les boîtes sont préférables. · A partir de 2 mois des croquettes adaptées à l’âge sont possibles. · 4 repas par jour jusqu’à 6 mois, puis diminuer à 3 (personnellement, je suis pour que le chat est à manger en libre service, s'il vient à manquer, il peut faire une hypoglycémie, certains d'entre eux peuvent même devenir agressifs) . Pas de lait ! · De l’eau en permanence. La nourriture doit être éloignée de la litière. SOLITUDE ET JEUX : · Le chaton jusqu’à 3 mois, a besoin de présence, de câlins et qu’on joue beaucoup avec lui. Ensuite, il apprendra à jouer tout seul avec une balle de ping-pong, ou autres jeux, mais éviter les jouets en mousse qu’il pourrait ingérer. Mettez-lui un poste d’observation près d’une fenêtre. · Contrairement aux idées reçues, le chat n’aime pas la solitude. Plus vous communiquez avec lui en lui parlant ou en jouant, plus le chat sera bien intégré et éveillé. TRANSPORT : · Habituez-le dès son plus jeune âge à être véhiculé. Choisissez un module de transport solide. Laissez-le ouvert et mettez-y des friandises. La curiosité l’y fera entrer et sortir tout naturellement. · Dans le module, faites-lui faire souvent des petits tours en voiture et autour de la maison, emmenez-le ne visite chez des amis (avec une litière) mais toujours sous votre surveillance. Vous aurez par la suite un chat adulte que vous pourrez emmener partout sans angoisse. Mais pour les petites absences, il est préférable de le laisser dans son environnement. SANTE : · Diarrhées, vomissements avec perte d’appétit sont à traiter immédiatement. La température du chat est de 38,5°C. · Attention aux signes de Coryza (larmoiements et éternuements). · Vermifuge 1 fois par mois jusqu’à 8 mois puis 2 fois par an minimum à l’âge adulte. · N’oubliez pas que vous avez 15 jours de soins gratuits auprès des vétérinaires SPA (si vous l'avez adopté là-bas). · Vérifiez les rappels de vaccins. CHATONS ET JEUNES ENFANTS : · Attention que le très jeune enfant n’étouffe pas le chaton dans ses bras, ne le fasse tomber ou ne joue trop brusquement. Le chaton risque de développer une peur agressive. Votre chaton ne doit en aucun cas sortir de la maison sans être entièrement vacciné et stérilisé. Ensuite habituez-le par petites périodes et sous surveillance au jardin. Socialisez votre chaton, jouez beaucoup avec lui, parlez-lui. Au début, ne le laissez pas seul toute la journée : c’est trop long pour un bébé.
-
-
Le chaton nouveau-né Le chaton nouveau-né est dépendant des soins maternels pendant plusieurs semaines; son immaturité est manifeste dans différents systèmes sensitifs, moteurs, communicatifs et sociaux. Il faut se rendre compte que le chaton nouveau-né est un être aveugle et sourd, paralysé des membres postérieurs, tout orienté vers la mamelle et la chaleur maternelle, préoccupé par une survie précaire, et que le chat adulte est un être visuel, mobile et actif chez qui le jeu, la chasse et les relations sociales sont les occupations majeures. Le nouveau-né pèse une centaine de grammes et l’adulte généralement plus de 3 kg. La température interne Pendant 15 jours, le chaton arrive peu ou mal à contrôler sa température interne, pour avoir chaud il lui faut une température extérieure de plus de 30°C. C’est rarement le cas dans tous les pays, à toute heure de la journée et en toutes saisons … dès lors les réflexes d’orientation vont l’aider encore : seul le contact avec ses frères et sœurs et avec sa mère pourra lui fournir la chaleur nécessaire à sa survie, voilà pourquoi les chatons d’une semaine dorment en paquets les uns sur les autres. C’est seulement au cours de la 3e semaine, si la température le permet, qu’ils s’essayeront à dormir seuls. L’odorat Outre le sens du toucher, c’est l’odorat qui guide le chaton nouveau-né à la mamelle. L’odorat est fort bien développé dès la naissance. En 3 jours, chaque chaton a établi une préférence de positionnement de tétée, c’est–à–dire qu’il s’est égoïstement choisi une mamelle (et une seule) et il s’y tiendra pendant quelques semaines. Le goût Une fois qu’il est à la mamelle, il faut téter. Le réflexe de tétée commence au 50e jour de la gestation. A la naissance, il sait donc parfaitement comment s’y prendre. En quelques jours, son sens gustatif s’est affiné et lui permet de distinguer le lait normal du lait salé. Au 10e jour après la naissance, il distingue les 4 saveurs de base : le salé, l’amer ; l’acide et le sucré. Après 26 jours, il peut commencer à ingérer des aliments solides. Deux jours plus tard, il apprend à boire dans un plat, il penche sa tête vers l’eau ou le lait, y trempe le menton et se lèche ; bientôt il trempera directement la langue pour laper. La vision et l’audition Le chaton nouveau-né semble aveugle et sourd : les yeux sont fermés (les paupières sont soudées) et les oreilles également (le canal auditif externe est clos). Pourtant dès le 2e ou 3e jour après la naissance, le chaton sursaute aux bruits forts et soudains. Les yeux s’ouvrent entre le 5e et le 14e jour, en moyenne après 8 jours. Les oreilles s’ouvrent entre le 6e et me 14e jour, en moyenne après 9 jours. Le chaton voit et entend mais relativement mal. Rapidement, en quelques jours, le chaton tourne la tête pour suivre les objets en mouvement (au 11e jour). De même s’oriente-t-il vers les bruits perçus (12e jour). Jusqu’à 21 jours, il doit tourner la tête en réponse à la lumière violente ; ensuite la pupille fonctionnera suffisamment pour éviter ce comportement. A 25 jours, l’acuité visuelle est considérée comme bonne. Quelques jours auparavant, la reconnaissance des sons est efficace et le chaton distingue les bruits connus des bruits inconnus auxquels il réagit par un réflexe de défense : le dos vouté et le sifflement de colère. La couleur de l’iris change à partir du 23e jour et les capacités visuelles sont équivalentes à celles de l’adulte à l’âge de 2 mois. L’évolution pondérale > naissance > 100 gr (entre 85 et 140) > 2 semaines > 200 gr > 4 semaines > 400 gr (entre 300 et 500) > 6 semaines > 650 gr > 8 semaines > 800 gr (entre 700 et 900) > 10 semaines > 1.200 gr (entre 1.000 et 1.400) > 12 semaines > 1.500 gr (entre 1.200 et 1.800) > 14 semaines > 2.000 gr (entre 1.600 et 2.200) La motricité Le chaton nouveau-né est paralytique ! Les membres antérieurs supportent à peine le poids du corps, les postérieurs traînent inertes, les griffes ne peuvent pas être rétractées ; le chaton arrive à ramper juste ce qu’il faut pour aller téter. En 10 jours, il se tient debout, en 15, il marche, en 18, il se déplace où l’envie le mène. C’est aussi à ce moment que le contrôle actif des muscles des oreilles lui donne une expressivité nuancée. Chaton n’est déjà plus un bébé. Au jour 19, il rétracte les griffes, au jour 20, il s’assied avec fermeté sans plus s’affaler sur le sol. Au jour 25, au lieu d’appeler sa mère en criant et pleurant, quand quelque chose le dérange ou l’effraie, il s’enfuit, siffle sa colère et gonfle le poil. C’est la révolution dans le nid ; la socialisation a commencé. L’équilibre est fermement assuré depuis plusieurs jours et le chaton corrige sa position dans l’espace et retombe sur ses pattes. Au jour 31 (en moyenne car cela peut varier du 23e au 40e jour), il grimpe et passe 70 % de son temps d’éveil dans le milieu environnant. Au jour 31, il enterre ses excréments, gratte le sol. Quatre jours plus tard, il gratte le bois, les supports verticaux. C’est le moment idéal pour lui apprendre à ne pas gratter le papier peint et pour lui donner un support préférentiel (éleveurs, c’est votre travail !). Au jour 38, disparaît le réflexe uro-génital (les éliminations réflexes) et débute la peur des humains (jusqu’à 3 mois et demi). Revenons aux éliminations ! A la naissance, le chaton est incapable d’éliminer seul. C’est la mère qui en léchant la région abdominale, périnéale et caudale de son rejeton, stimule le réflexe uro-génital, c’est-à-dire les éliminations des selles et urines qu’elle ingère aussitôt. Cela maintient le nid propre, évite les mauvaises odeurs qui attireraient, dans la nature, les prédateurs du chat. Si ce réflexe disparaît entre le 23e et le 39e jour, cela n’empêche pas les éliminations contrôlées et volontaires de se faire dès l’âge de 3 semaines. L’apprentissage du bac à litière se fait par imitation de la mère. On aura donc soin de le mettre à proximité du nid, mais à distance de l’aire d’alimentation ! Au 30e jour, le développement du réflexe de gratter le sol le poussera vers le bac à litière où l’odeur des excrétions le conduira à éliminer. C’est ainsi que la plupart des chatons sont acquis, à l’âge de 8 semaines, tout éduqués à la propreté. Nous avons vu qu’il faut 2 semaines accomplies pour que le chaton marche. Avant cela, s’il veut jouer, il doit jouer seul : il tente de donner des coups de pattes aux objets en mouvement. C’est à 3 semaines que débute le jeu social avec « coup de poings » et morsures éventuelles. Au 35e jour apparaissent les jeux complexes ; traquer, chasser, courber le dos. La lutte voit le jour à la 6e semaine, les bonds et les sauts entre les 17e et 47e. Conclusion En manipulant les chatons, c’est-à-dire en les retournant, en les caressant, en les stimulant … on peut accélérer d’un jour ou plus le développement général, aussi bien l’âge de la marche et le moment de l’ouverture des yeux que les capacités sensorielles ou l’activité ludique. Par contre, en privant les chatons de stimulations (milieu soporifique, obscurci, appauvri) on en fait des retardés mentaux ! Sources : http://www.eurochats.com/dossiers/2003-04/index.php
-
Les chats ont la peau TRÈS fine et absorbe donc beaucoup plus les huiles essentielles. Ils ne peuvent pas éliminer les phénols et d'autres toxiques car il leur manque une enzyme, la glucuronyl tranferase (cette enzyme permet de rendre les toxiques solubles dans l'urine et donc de les éliminer). Par exemple pour un toxique donné on aura une élimination de 50-60% pour l'homme et le chien et de 3% pour le chat. C'est pour cette raison par exemple que l'aspirine peut être mortelle au chat. Ces phénols peuvent donc s'accumuler dans le foie du chat sans s'en apercevoir dans les premiers temps (le chat ne se sent pas malade) jusqu'à des doses toxiques. Et le foie peut devenir vraiment malade... jusqu'à la mort. Peu d'études sont faites sur l'usage de l'aromathérapie chez les chiens et chats, que ce soit en usage thérapeutique ou en études toxicologiques (même pas une dizaine d'articles dans les revues scientifiques). Des études ont prouvé la toxicité d'une surexposition à l'huile essentiel de "tea tree" en application sur les poils : dépression, faiblesse, manque de coordination. Surexposition pourquoi ? En dehors de la toxicité des huiles essentielles, c'est aussi parce que les maîtres ne se rendent pas toujours compte que les huiles essentielles c'est au poids et qu'un chat c'est encore moins lourd qu'un enfant !!! Par exemple : si on donne une goutte d'huile essentiel à un enfant, il faudrait donner 1/4 de goutte au chat. Impossible à doser ! Du coup la très grande prudence est de mise. Et c'est sûr que les chats traités à l'aromathérapie actuellement sont des cobayes. Maintenant je crois que de nombreuses études doivent encore être faites pour évaluer la toxicité de telle ou telle huile, à quel dosage, etc etc... (car elles ne sont pas toutes toxiques pour les chats). Je reste persuadée que certaines huiles essentielles, ou tout du moins, les hydrolats peuvent être très intéressants. Si vous voulez utiliser l'aromathérapie pour votre chat, les hydrolats sont la seule méthode sûre. Ils sont merveilleux parce que les chats peuvent les supporter sans problème, il n'y a pas de toxicité. Ils peuvent être (pulvérisés ?) sur le chat pour désodoriser, ou pour un traitement anti-puces ou anti-tiques, ou encore peuvent être utilisés pour nettoyer les oreilles ou comme agents calmants. Ils ne sont pas aussi concentrés que les huiles essentielles et ne requièrent pas la méticulosité et la dilution qu'elles nécessitent. [...] Vous pouvez facilement mélanger et combiner différents hydrosols pour différents usages pour soigner votre chat. En tout état de cause les huiles essentielles potentiellement dangereuses sont celles contenant des PHENOLS qui sont HEPATOXIQUES (toxique pour le foie), en particulier : Origan, Thym, Eucalyptus, Girofle, Cannelle, Bay, Persil, Sariette. Celles contenant des CETONES sont NEUROTOXIQUES : Cèdre, Sauge, Hysope, Cyprès, Lavande, Eucalyptus, Menthe, Carvi, Citronnelle ,Girofle, Gingembre, Camomille, Thym, Romarin. Vu la dangerosité potentielle de nombreuses huiles essentielles pour les chats et l'absence de recul scientifique sur la question, j'ai préféré ne pas préciser l'espèce et le chémotype. Il n'est de toutes façons pas possible à l'heure actuelle de lister avec certitude celles qui sont dangeureuses et celles qui ne le sont pas. Il vaut mieux se dire qu'elles le sont toutes. Source : http://raffa.grandmenage.info/post/2005/06/14/Huiles_essentielles_et_chats___Attention_danger
-
L'huile de Neem : Le Neem ( Azadirachta indica ) est un arbre tropical, cousin du Mahogany, un arbre indigène de l’Inde appelé en français: Margousier. Elle peut être utilisée contre les tiques et les puces. Dosage : utiliser le produit pur Appliquer directement l'huile sur l'animal, dans ce cas, laisser agir une demi-heure, puis rincer à l'eau. Stockage : Conserver au frais, sec et à l’abri de la lumière. L’huile de Neem à tendance à se solidifier à une température inférieure à 25°C. Ce phénomène n’a aucune importance sur sa qualité. Nous conseillons de la réchauffer si nécessaire avant utilisation en la passant sous un filet d’eau tiède pour la liquéfier.
-
Le géraniol : Aussi appelé rhodinol, est un alcool terpénique insaturé. C'est également un monoterpène. Il constitue une majeure partie de l'huile de rose et de palmarosa. Il est également présent dans les huiles essentielles de géranium, citron et citronnelle. On peut également utiliser cette molécule comme répulsif d'insectes. Bien qu'il chasse les moustiques, mouches, cancrelats, fourmis et les tiques, il est produit par les abeilles pour les aider à marquer les fleurs à nectar et localiser l'entrée de leurs ruches. Cependant, il n'est pas prouvé à l'heure actuelle qu'il ait un effet répulsif sur les insectes. Des produits en pipette existent qui en contiennent (soit disant 100% naturel) : Biospotix, Ecophar
-
Pour l'entourage du chat : placez sous les coussins et les endroits où votre chat à l'habitude de s'y reposer des feuilles fraiches de lavande. Elles seront à remplacer régulièrement car elles doivent être bien fraiches et odorantes pour être efficaces. L'aspirateur : passez-le régulièrement et pourquoi de pas mettre quelques gouttes d'huiles essentielles de lavande et d'arbre à thé (Tea-Tree) sur le sac ou sur un coton à l'intérieur du sac, pour être sûr que les puces n'y résisteront pas ? Les huiles essentielles ainsi utilisées ne seront pas nocives pour votre compagnon.
-
Commençons par le vinaigre (mieux encore si vous en trouvez : du vinaigre de lavande) : En prévention, à faire régulièrement à partir du mois d'avril jusque fin octobre, voire novembre (tout dépend du temps qu'il a fait en été et au début de l'automne). Ajouter du vinaigre dans un bol rempli d'eau. Vous passerez avec un gant de toilette, que vous aurez humidifié préalablement avec l'eau vinaigrée, sur tout le corps de l'animal. Attention, pas sur les yeux, pas sur les babines, pas sur la truffe. Le haut de la tête, les oreilles côté extérieur, les joues et le reste du corps, sans problème. N'oubliez pas la queue de l'animal mais attention ne touchez pas à son anus ni à ses parties génitales. Veillez à ce que l'animal ne se lèche pas pendant quelques heures, surtout si c'est un chat car il aura tendance plus que les autres à vouloir le faire. Si l'animal est déjà infecté, cette méthode est à pratiquer si possible au dehors de votre intérieur car les puces ne seront pas tuées, mais fuiront ventre à terre. Fabriquez votre vinaigre à la lavande avec “de vraies fleurs” : Pour cette préparation, il vous faut 100 grammes de fleurs de lavande fraîches. Vous les lavez puis vous les faîtes légèrement sécher pendant 12 à 24h. Dans un bocal hermétique, vous mettez les 100 gr de lavande, puis vous versez votre vinaigre (de cidre de préférence ou blanc) qui doit remplir complètement votre bocal. Ensuite, mettez votre bocal dans endroit exposé au soleil ou à une autre source de chaleur (radiateur ou cheminée). Vous laissez macérer pendant 3 semaines, remuez de temps en temps le bocal. Après cette période de macération, vous filtrez votre vinaigre à travers un vieux torchon. Votre vinaigre aura une teinte ambrée. Pressez bien les fleurs pour en extraire tout le jus. Mettez dans un flacon ou une bouteille. Attention : ne pas utiliser le vinaigre de lavande à base d'huiles essentielles de lavande. Source : http://baratrucs.discutforum.com/t111-traitement-naturel-antipuce
-

Quel est son âge humain ?
Liliblue35 a répondu à un(e) sujet de Liliblue35 dans Généralités sur les chats
Le seuil de sénescence : Si votre animal à franchi la ligne bleue, faites réaliser un bilan de santé par votre vétérinaire. Des variations sont possible en fonction, notamment, du mode de vie et de la médication de votre animal. Pour un chat ce seuil se trouve entre 11 et 12 ans. Il peut apparaître chez lui des raideurs articulaires, des difficultés locomotrice, du diabète, des problèmes de dents, problèmes urinaires... d'où l'importance de consulter un vétérinaire pour lui permettre de vivre mieux sa vieillesse. -
-

Résumé sur les maladies les plus courantes chez le chat
Liliblue35 a posté un sujet dans Les maladies du chat
La rhino-trachéite virale féline C'est une infection virale des voies respiratoires supérieures similaire au rhume chez l'humain. Elle se manifeste par des éternuements, un écoulement du nez et des yeux et de la toux. Une fois le virus entré dans l'organisme du chat, l'infection peut s'établir de façon permanente. L’entérite féline Appelée aussi maladie du jeune âge, c’est la principale maladie mortelle des chatons. Le virus se transmet par les excréments, et les symptômes sont de violents vomissements, des diarrhées et une déshydratation. Réagissez vite car le chat atteint peut décéder dans les 24 heures. Le traitement se fait par antisérum intraveineux. Il existe également un vaccin. La leucémie féline (FeLV) Est une affection du sang dont l’issue est fatale. Elle est provoqués par un virus qui se transmet par la salive et qui détruit le système immunitaire. L’animal perd du poids rapidement et il souffre de gingivite. Il n’y a pas de traitement mais il existe un vaccin. Inconnu il y a 20 ans, le virus de la leucémie féline (FeLV) est maintenant considéré comme la principale cause de mortalité chez le chat. Les chats infectés par le FeLV vivent rarement plus de trois ans. En effet, le FeLV détruit la capacité du chat à combattre les infections de toutes sortes et l'animal meurt d'une maladie à laquelle il aurait normalement été capable de résister. Après des années de recherche, un vaccin efficace contre le FeLV a été mis sur le marché en 1985. Comme la leucémie féline est si commune (jusqu'à 30% des chats vivant en groupe y auraient été exposés), la vaccination est fortement conseillée pour tous les chats en bonne santé. La chlamydia C'est une infection des voies respiratoires supérieures causée par une bactérie. Elle peut se traduire par de la fièvre et un écoulement oculaire et nasal. Les infections des voies respiratoires supérieures se propagent facilement d'un chat à l'autre par, entre autres, les éternuements. En outre, même un chat apparemment en santé peut infecter votre animal de compagnie. Votre vétérinaire peut protéger votre chat contre toutes les principales maladies respiratoires (rhino-trachéite, infection à calicivirus, chlamydia) et la pan-leucopénie avec un seul vaccin. La vaccination devrait débuter entre 7 et 9 semaines suivie à 3 mois et ensuite annuellement. Le FIV (virus d’immunodéficience féline) Se transmet par le léchage, par de la nourriture préalablement infectée, par l’allaitement ou lors de l’accouplement. Après une période de légers malaises et de fièvre où se développent des ganglions, les défenses immunitaires sont atteintes. Le chat cesse de s’alimenter et perd du poids; il souffre de gingivite, de diarrhées, de vomissements et de complications oculaires ou dermatologiques. Des antibiotiques ou des corticoïdes peuvent temporairement réduire les symptômes, mais il n’y a pas de guérison et l’issue est fatale. Les porteurs de FiV, même bien portants, doivent être tenus à l’écart des chats non contaminés. La péritonite infectieuse féline (P.I.F) La P.I.F. n'est pas une maladie infectieuse typique. Il s'agit d'une maladie à médiation immunitaire, c'est-à- dire que le système immunitaire du chat, en essayant de protéger l'animal contre la P.I.F., accélère plutôt la progression de la maladie. Selon certaines études, 25% des chats du monde entier seront exposés à un coronavirus, le groupe viral qui comprend le virus de la P.I.F. Cette exposition peut ou non engendrer une P.I.F. Toutefois, dès l'apparition des signes, la maladie ne peut être traitée, ni guérie efficacement. Et, dans presque tous les cas, la P.I.F. est fatale. Quoique les symptômes varient grandement, certains signes sont caractéristiques de la P.I.F. Comment savoir si mon chat est atteint ? La forme la plus grave de P.I.F., appelée forme humide, l'abdomen du chat se gonfle de fluide, par suite de dommages étendus au système circulatoire. Le fluide peut aussi s'accumuler au niveau du thorax, causant des difficultés de respiration. Les autres signes sont la présence de fièvre et d'un léger écoulement nasal et oculaire, la perte d'appétit et de poids et l'affaiblissement. Le signe clinique le plus courant de la forme humide de la P.I.F. est le gonflement, progressif et sans douleur, de l'abdomen, résultant de l'accumulation de liquide, par suite de dommages étendus au système circulatoire. La forme plus prolongée de P.I.F. est appelée forme sèche, parce que peu de liquide s'accumule dans l'abdomen. Les signes les plus courants sont des désordres du système nerveux central, comme l'incoordination et la paralysie partielle ou complète des pattes postérieures, des convulsions, des changements de personnalité, de même que des affections oculaires. D'autres signes non spécifiques comprennent un mauvais état de santé général, de la fièvre, une perte de poids et de l'anémie. Symptômes de la P.I.F : * Gonflement de l'abdomen * Écoulement nasal ou oculaire * Paralysie des pattes postérieures * Convulsions * Changements de personnalité * Affections oculaires * Mauvaise santé générale, fièvre, perte de poids, anorexie, anémie. Les chats qui courent le plus de risques de développer un P.I.F. sont : * Les chats gardés à l'extérieur * Ceux élevés en pension pour chats ou dans un foyer où vivent d'autres chats * Ceux victimes de malnutrition, de surpopulation ou d'infections * Les chats traités à fortes doses de stéroïdes ou de d'autres médicaments qui affaiblissent le système immunitaire * Les chats continuellement infectés par le virus de la leucémie féline (près de 50% des chats atteints de P.I.F. sont aussi infectés par le virus de la leucémie féline). La P.I.F frappe plus fréquemment les très jeunes et les très vieux chats. L'incidence de la maladie semble atteindre son point culminant chez les chats âgés de 6 mois à 2 ans. Le nombre de cas augmente aussi beaucoup parmi les chats âgés entre 11 et 15 ans. De plus, la P.I.F. se déclare un peu plus souvent chez les chats de race. Comment le virus se propage-t-il parmi les chats ? Le virus de la P.I.F. peut se retrouver dans la salive, l'urine et les fèces des chats infectés. La bouche et le nez sont les voies naturelles d'infection. Ainsi, la P.I.F. apparaît le plus souvent parmi les chats qui sont gardés ensembles dans une pension pour chats ou dans une maison où vivent plusieurs chats. Il est aussi possible, mais peu probable, que le virus soit transmis via les vêtements, le panier du chat, le plat de nourriture et les insectes. Loin de son hôte, le virus de la P.I.F. est instable et peut être détruit avec la plupart des détergents domestiques. La toxoplasmose Se répand par un parasite qui vit dans l’organisme de tous les êtres vivants à sang chaud et qui se trouve dans les excréments. Environ 50% des chats ont la toxoplasmose à un moment ou un autre de leur vie, mais les symptômes (diarrhées, essentiellement) apparaissent uniquement chez les chats dont le système immunitaire est défaillant. Le parasite survit dans les selles pendant 24 heures avant d’être transmissible à l’homme. Se débarrasser des litières usagées rapidement permet de limiter le risque de transmission qui peut être grave chez la femme enceinte où le virus peut causer de graves lésions à l’embryon. Il n’existe pas de vaccin, mais un traitement à base de vermifuge est suffisant. La rage Cette maladie mortelle, qui peut atteindre l’homme, se transmet par morsure, coup de griffe ou léchage. Les symptômes apparaissent dans une période allant de dix jours à six mois : salivation agressivité, pupilles dilatées, convulsions. En quelques jours la maladie évolue vers une paralysie générale et la mort. La rage est une infection mortelle du système nerveux qui s'attaque à tous les animaux à sang chaud, y compris les humains. Traditionnellement, les chiens ont été considérés comme les principaux porteurs de la rage. Cependant, depuis 1981, le nombre de cas de rage rapporté chez les chats a dépassé celui chez les chiens. La rage représente un danger pour la santé de la population en général et celle des propriétaires d'animaux de compagnie. Plusieurs états américains exigent la vaccination contre la rage et la plupart des vétérinaires recommandent la vaccination pour tous les chats et les chiens peu importe la législation en vigueur. La rage peut se transmettre par morsure de l'animal infecté. Même, les chats gardés à l'intérieur peuvent entrer en contact avec un porteur de rage dans une cave, un garage ou un grenier. Comme il n'existe aucun traitement contre cette maladie, seule la vaccination peut protéger votre animal de compagnie. Problèmes urinaires Un chat qui peine à uriner ou dont les urines contiennent des traces de sang présente probablement une maladie de l'appareil urinaire. Soyez vigilant. L'élimination de l'équilibre chimique du corps de votre chat : une rétention urinaire peut donc intoxiquer tout le système. En cas de doute, consultez rapidement votre vétérinaire. Un simple examen externe n'est pas toujours concluant. C'est pourquoi toute indication sur le comportement de votre chat à la maison sera utile au diagnostic. Le vétérinaire essaiera d'obtenir une petite quantité d'urine pour l'analyser en pressant la vessie ou en la vidant avec une seringue, mais l'insertion d'un cathéter peut être nécessaire. Le plus simple est d'apporter un échantillon d'urine vous-même, si vous le pouvez. Des examens complémentaires sont souvent requis : analyses sanguines pour les infections ou insuffisances rénales, échographies ou radiographies pour examiner la vessie. Des traceurs peuvent être injectés pour examiner l'appareil urinaire. La cystite Les symptômes : Le problème le plus fréquent de la vessie et de l'appareil urinaire chez les chats est l'infection. Celle-ci remonte l'urètre jusqu'à la vessie, provoquant une inflammation (cystite). Les femelles ayant l'urètre plus court que les mâles, elles y sont davantage prédisposées. Les parois enflammées de la vessie deviennent alors irritables, c'est pourquoi le chat tente d'uriner même lorsqu'elle est vide. Les parois peuvent aussi saigner. Si le chat n'est pas soigné, l'infection bactérienne risque de se propager vers les uretères qui véhiculent l'urine des reins à la vessie, et d'atteindre ainsi les reins. Cela peut s'avérer fatal. Le traitement : La plupart des infections bénignes se traitent aux antibiotiques; il est donc conseillé d'agir rapidement. Afin de réduire tout risque de rechute, suivez le traitement jusqu'au bout même si les symptômes s'estompent. Encouragez votre chat à boire; cela l'aidera à évacuer l'infection de l'appareil urinaire. Vous pouvez par exemple saler un peu plus sa nourriture. Votre vétérinaire saura vous conseiller. Les calculs : L'appareil urinaire des chats peut être atteint d'autres maladies plus graves. La maladie féline du bas appareil urinaire (ou syndrome urologique félin) affecte principalement les mâles. Les causes en sont aussi bien bactériologiques que cristaux dans une urine alcaline. L'urine est alors concentrée et les sels y forment un dépôt granuleux de cristaux ou calculs minuscules qui bloquent l'urètre. Celui-ci est particulièrement étroit chez les mâles; si des résidus le bouchent, le chat ne pourra plus uriner. C'est un cas d'urgence médicale. Les tumeurs : Des polypes ou des tumeurs à l'entrée de la vessie peuvent provoquer des douleurs lorsque le chat urine. Les tumeurs entraînent souvent des ulcères et des saignements Les obstructions partielles ou complètes de l'appareil urinaire doivent être retirées, mais certaines tumeurs sont incurables. Le traitement peut comporter un régime alimentaire. La prévention des maladies urinaires Il est indispensable de garantir à votre chat un accès permanent à l'eau fraîche, surtout si vous le nourrissez d'aliments déshydratés. Bien que la plupart des chats préfèrent s'abreuver à l'extérieur, son bol d'eau doit toujours rester plein. Il existe des aliments pour chats contenant peu de magnésium, ce qui permet d'acidifier l'urine, diminuant ainsi la formation de cristaux. Un chat qui fait habituellement ses besoins à l'extérieur mais qui n'aime pas le froid sera particulièrement exposé aux cystites en hiver. En effet, il aura tendance à laisser sa vessie se surcharger. Dans ce cas, assurez-vous qu'il sort régulièrement ou mettez une litière à sa disposition à l'intérieur. Enfin, sachez qu'un accident ou une chute peut provoquer une rupture de la vessie qui, si elle n'est pas dépistée rapidement, entraîne elle-même de graves problèmes. Se poser les bonnes questions : * L'urine comporte-t-elle des traces de sang? * Le chat urine-t-il plus fréquemment et en petites quantités? * Y a-t-il des taches d'urine ou de sang dans la maison? * Le chat choisit-il des endroits inhabituels pour uriner? * Semble-t-il perturbé et mal à l'aise? * Se lèche-t-il souvent les parties génitales? * Avez-vous remarqué du sang? * Son pénis est-il souvent visible? * Boit-il plus que d'habitude? * Est-il léthargique? * Manque-t-il d'appétit? * S'évanouit-il? Problèmes de digestions Vomissements anormaux, diarrhée ou constipation sont généralement les symptômes d’un dysfonctionnement de l’appareil digestif. Les vomissements font partie du système de défense naturel du chat et permettent l’élimination d’aliments nuisibles ou en excès. Il est normal pour certains chats (surtout ceux qui mangent leurs proies) de vomir une à deux fois par semaine. Un chaton peut recracher des vers, signe que son traitement vermifuge a été négligé. Pourtant, une fréquence ou une apparence inhabituelle de vomissement doit attirer votre attention. Vomissements anormaux Les obstructions intestinales : Si votre chat vomit plus fréquemment que d’habitude, s’il recrache du sang coagulé ou s’il perd du poids, il peut souffrir d’une obstruction intestinale ou d’une tumeur. Consultez alors immédiatement un vétérinaire. Les gastrites : Plusieurs formes de gastrite peuvent engendrer des crises de vomissements aiguës. Gardez le chat à la maison et donnez-lui de petites quantités d’eau. S’il vomit l’eau, restreignez les prises de liquide pendant huit à douze heures pour permettre à l’estomac de se reposer. Donnez alors une cuillerée à soupe d’eau toutes les trente minutes afin d’éviter la déshydratation et supprimez toute nourriture pendant les huit heures qui suivent la dernière attaque. Reprenez alors l’alimentation par petites quantités. Si le chat continue à vomir, consultez rapidement un vétérinaire. L’entérite infectieuse : Les chats et chatons non vaccinés sont exposés à l’entérite infectieuse. Dans les formes les plus aiguës de la maladie, le chat souffre de crises de vomissements graves et fréquentes, de diarrhée et de douleurs abdominales. L’entérite infectieuse est souvent fatale. Elle est aussi très contagieuse. La meilleure prévention reste la vaccination mais, malheureusement, celle-ci n’est pas efficace contre toutes les formes de la maladie. Ingestion d’objet : Des vomissements peuvent également survenir après l’ingestion d’un petit objet provoquant un blocage de l’intestin. Radiographies, endoscopie, voire chirurgie, peuvent être prescrits pour localiser et retirer l’objet. Ce problème est toutefois moins fréquent chez les chats que chez les chiens. Il peut arriver au chat de régurgiter sa nourriture avant même qu'elle ait atteint l’estomac et éventuellement de l’ingérer à nouveau. Ce phénomène occasionnel et bénin peut se produire lorsque le chat mange trop vite. Cependant, s’il persiste, demandez conseil à votre vétérinaire. La diarrhée : Des excréments informes ou liquides peuvent être le symptôme de problèmes alimentaires ou digestifs comme une suralimentation, un changement de régime mal supporté, une nourriture trop riche ou la présence de vers. Certains chatons présentent une intolérance au lactose contenu dans le lait de vache. Un chaton dont la diarrhée dure plus de 48 heures doit être examiné par un vétérinaire, même s’il semble en bonne santé. Que faire ? Si votre chat subit brusquement une crise de diarrhée, gardez-le à la maison et ne lui donnez aucun aliment solide pendant 24 heures. Approvisionnez-le seulement en eau fraîche. Cette période passée, donnez-lui la moitié d’une ration journalière normale, en augmentant progressivement les quantités si la diarrhée ne réapparaît pas. Si elle persiste ou s’il y a présence de sang dans les selles, consultez immédiatement le vétérinaire. Le dérèglement hormonal : Une perte de poids accompagnée d’une diarrhée chronique peut être le symptôme d’un dérèglement hormonal, une hyperactivité de la glande thyroïde, par exemple. Le chat peut alors développer un appétit vorace. Les plus communément touchés sont les chats plus âgés. Votre vétérinaire effectuera un test sanguin afin d'évaluer les taux d’hormones. Dans la plupart des cas, l’ablation de la glande thyroïde constitue une solution efficace. Des excréments noirs et goudronneux peuvent indiquer une hémorragie interne ou une tumeur, à toujours considérer sérieusement. Si possible, apportez un échantillon récent des selles de votre chat pour les faire analyser afin d’aider le vétérinaire dans son diagnostic. Transportez cet échantillon dans un récipient propre, étiqueté, avec le nom du chat, la date et l’heure du prélèvement. Les allergies alimentaires De nombreux chats présentent une sensibilité particulière à un aliment (au foie, par exemple), voir à plusieurs. Le lait ne doit pas être considéré comme une boisson susceptible de remplacer l’eau, mais comme un aliment. Si votre chat souffre de diarrhée chronique, supprimez tous les produits laitiers de son alimentation. Vous pourrez diminuer la diarrhée chez un chat connu pour ses allergies à certains aliments en supprimant toute nourriture préparée à la maison et en privilégiant les aliments du commerce de bonne qualité. Votre vétérinaire vous conseillera. En outre, veillez attentivement à ce que votre chat ne mendie pas sa nourriture ailleurs ou ne fouille pas dans les poubelles, ce qui bien évidemment, annulerais l’effet des précautions que vous prenez. La constipation Les causes : La constipation peut avoir des causes extrêmement simples. Une litière souillée, par exemple, peut inciter un chat à retenir ses selles. Or, lorsqu’il les retient, son intestin absorbe le fluide contenu dans les selles, ce qui peut les rendre trop denses pour être évacuées. Par ailleurs, le stress, l’ingestion de boules de poils, la déshydratation, une tumeur ou une obstruction intestinale (due, par exemple à des os de poulet) peuvent être à l’origine de la constipation. Enfin, c’est un phénomène fréquent chez les chats âgés. Les symptômes : Les chats constipés rejettent des excréments durs et secs, voire aucun. Après plusieurs efforts, les selles peuvent devenir liquides. Vous serez alerté lorsque vous remarquerez que pendant plusieurs jours, votre chat ne défèque plus ou qu’il essaie en vain. Ne confondez pas cette attitude avec les efforts faits pour uriner en cas de cystite (voir Problème urinaire). Si la constipation dure, le chat risque de s’affaiblir et de se déshydrater progressivement. S’il se met en outre à vomir, emmenez-le chez le vétérinaire. Le traitement : Le vétérinaire éliminera la masse décale en administrant au chat un purgatif ou un laxatif, nécessitant peut-être une anesthésie générale. Les substances émollientes ou purgatives (comme le son) peuvent être utiles pour débloquer les selles. Le vétérinaire prescrira un régime pour quelques jours ou bien vous conseillera de composer une alimentation à base de poisson, poulet, son ou d’œufs pas trop cuits. Radiographie, échographie, tests sanguins peuvent être effectués pour déterminer les causes du problème, suivre les évolutions et prescrire le traitement approprié. En fonction des résultats, il est possible que votre chat ait besoin d’un régime alimentaire spécial à vie. Les jeunes chats (2 à 9 ans) présentent couramment un « mégacôlon » (dilatation anormale du gros intestin, accompagnée d’un épaississement de la paroi) qui provoque une retenue des selles. Si un simple traitement par médicaments peut souvent suffire, il est parfois nécessaire de retirer la partie du côlon atteinte. Source : Votre chat (John et Caroline Bower) -

PLANTES DANGEREUSES pour les CHATS
Liliblue35 a répondu à un(e) sujet de Admin-lane dans Tout sur le chat
-

PLANTES DANGEREUSES pour les CHATS
Liliblue35 a répondu à un(e) sujet de Admin-lane dans Tout sur le chat
Prévention de l'empoisonnement par les plantes chez les chats : Étant donné que le chat est un petit animal, l'absorption d'une faible quantité d'un produit très toxique peut être dangereuse. Parfois le seul fait de se frotter à une plante toxique peut être risqué : la sève qui se sera déposée sur son pelage pourra provoquer un empoisonnement quand le chat fera sa toilette. - Garder le chat à l'écart de TOUTES les plantes, toxiques ou non, sauf celles que l'on sait sans danger comme la cataire ou l'herbe-à-chats. On peut trouver des nécessaires de cultures dans les animaleries. - Donner au chat assez de jouets, particulièrement ceux qui contiennent de l'herbe-à-chats, ou lui donner un autre chat comme compagnon de jeu pour éviter la solitude et l'ennui. - S'assurer que le régime du chat est bien équilibré. Ne JAMAIS lui offrir quelque chose qu'on ne mangerait pas nous-même. Les feuilles de carottes et de rhubarbe sont extrêmement toxiques, pour les êtres humains comme pour les animaux. - Quand on ne sait pas si la plante est toxique, la garder hors de portée du chat. - Les bulbes à fleurs sont toxiques, les conserver dans des contenants et des endroits inaccessibles. - Placer les plantes d'intérieur dans des plateaux contenants de gros éclats de pots ou des cailloux pointus. Le chat n'aimera pas s'en approcher. A l'extérieur, couvrir le sol de gravier ou utiliser des produits pour tenir les animaux à l'écart. - Les chats peuvent s'empoisonner avec une plante traitée avec un insecticide ou un herbicide. Si les produits utilisés agissent longtemps, considérer que la plante est toxique. - Tenir le chat à l'écart de toute plante qui souffre de mildiou, de moisissures ou d'une maladie provoquée par un champignon ou un virus. Même s'il ne s'agit pas d'une plante toxique, elle pourra rendre le chat malade. Symptômes d'empoisonnement et mesures à prendre : Les symptômes les plus courants sont: vomissements répétés, diarrhée, refus de manger, pâleur des gencives ou de la langue, enflure ou irritation de la langue, douleurs abdominales et convulsions. Amener immédiatement le chat chez le vétérinaire le plus proche. Si on sait quelle plante il a ingéré, en apporter un morceau ainsi qu'un échantillon de vomissure. Si c'est possible, il peut être utile de connaître l'appellation scientifique (nom latin) de la plante. Quand un chat mange trop d'un aliment comme la laitue, la grande quantité de fibres absorbées peut provoquer un blocage des intestins, à moins que le chat ne vomisse peut de temps après. Par conséquent, si le chat avale une grande quantité de matières végétales, même s'il s'agit d'herbe-à-chats, et qu'il ne vomit pas, consulter le vétérinaire. Précautions à prendre : - Connaître le nom des plantes qu'on a à la maison et/ou dans le jardin, de préférence leur nom latin (le nom commun diffère souvent d'une région à une autre et n'est pas un indice fiable. - Lorsqu'on achète une plante, demander au vendeur de l'étiqueter et prendre soin de garder cette étiquette sur la plante. En cas d'ingestion, vérifier rapidement par téléphone si la plante en question est potentiellement toxique ou non. - Une autre erreur est de présumer que la plante ingérée ne doit pas être toxique ou que la personne ne réagit pas immédiatement à l'ingestion. Plusieurs toxines prennent plusieurs heures avant de produire leur effet et à ce moment le traitement devient plus difficile. Dès qu'on constate l'ingestion, un simple coup de téléphone peut éviter bien des ennuis. C'est préférable de toujours apporter un échantillon complet de la plante (ou du moins une branche avec fruits ou fleurs) près du téléphone afin de pouvoir bien la décrire si on n'en connaît pas le nom. - Garder toute plante potentiellement toxique hors de la portée des enfants et des petits animaux. Finalement ne jamais consommer des plantes sauvages sans être absolument certain de leur identité. -

PLANTES DANGEREUSES pour les CHATS
Liliblue35 a répondu à un(e) sujet de Admin-lane dans Tout sur le chat
Ajout : Abricot (noyau) Abrus à chapelet Aglaonema modestum Aloès Amaryllis Arum d'Éthiopie Asparagus plumeux Asparagus setaceus Asparagus sprengeri Azalée Cactus candélabre Caladium Caladium 'Florida Beauty' Cerise (graines et feuilles flétries) Cerisier de Jérusalem Cinéraire Clématite Cordyline australis Crocus d'automne Croton Croton miniature Cycade du Japon Cycadophytes Cyclamen Dieffenbachia Dieffenbachia amoena Dieffenbachia maculé Dieffenbachia 'Tropic Snow' Digitale Dracaena deremensis 'Warneckii' Dracaena 'Janet Craig' Dracaena marginata Dracaena surculosa Dragonnier Dragonnier balsamique Dragonnier balsamique 'Massangeana' 'Elaine' Easter lily Eucalyptus Ficus 'Cuban Laurel' Ficus elastica Figuier panduriforme Figuier pleureur Géranium Gui de chêne Gypsophile Hedera helix Herbe à puce Houx If commun Ipomée de Horsfall Jonquilles Kalanchoé Kalanchoe beharensis Laurier rose Lierre 'Branching' Lierre d'argent Lierre d'été Lierre glacier Lierre grimpant Lierre grimpant 'Needlepoint' Lierre grimpant 'Sweetheart' Lis de Pâques Lis oriental Lis spéciosum Lis tigré Marijuana Marronnier Monstera Monstera deliciosa Muguet Narcisse Nephtytis Oignon Pêche (feuilles flétries et noyaux) Philodendron Philodendron à feuilles incises Philodendron cordé grimpant Philodendron de selloum Philodendron de Selloum Philodendron 'Red Emerald' Philodendron rougissant Philodendron selloum Plant de tomates (fruit vert, tige et feuilles) Plante-araignée Podocarpe à grandes feuilles Poinsettia (faible niveau de toxicité) Pomme (graines) Pothos Pothos doré Primevère Reine de marbre Rhododendron Ricin Safran officinal Sansevière à trois bandes Schefflera Scindapsus Scindapsus aureus Scindapsus pictus 'Argyraeus' Séneçon de Rowley Solanacées Spathiphyllum Strélitzia Sumac occidental -

Comment nourrir son chat ?
Liliblue35 a répondu à un(e) sujet de Liliblue35 dans L'alimentation du chat
Sa nourriture après la sterilisation doit-elle changer ? Oui, une alimentation adaptée doit-être donnée pour éviter avant tout les problèmes urinaires et ensuite, la prise éventuelle de poids. Choisissez avant tout des croquettes qui préviennent les risques de struvites (calculs urinaires et cystites) chez votre chat. Elles augmenteront l'acidités des urines ce qui diminuera énormément le risque de formation de petits "cailloux" qui boucheraient la sortie de l'urètre chez le mâle ou des microbes plus chez les femelles. Ces croquettes doivent être très pauvre en sel, magnésium et autres sels minéraux aggravant les risques de ce types de maladies. Il en existe également des lights si après un an votre chat commence à prendre du poids. Car après la stérilisation, il va se mettre a manger plus et à bouger moins. Les croquettes doivent toujours être accompagnées d'une gamelle d'eau fraiche (à température ambiante et propre). Pour changer son régime : effectuez cela progressivement. Mélangez d'abord seulement 10% du nouvel aliment à l'ancien, puis d'augmenter peu à peu les proportions (tout en diminuant la part de l'ancien aliment). La transition peut se faire sur environ 2 à 3 semaines. Ce qui évitera les problèmes digestifs. Suggestions de marques de croquettes pour chats stérilisés (pas d'ordre de préférence mais les marques vétérinaires sont plus fiables à mon avis) : * Croquettes Hill's Feline Sterilised Cat Young Adult : Croquettes équilibrées pour les chats stérilisés de 6 mois à 7 ans, pour un animal en forme et en bonne santé pendant longtemps. Avec de la L-carnitine et la L-lysine pour maintenir le poids de forme. * Croquettes Hill's Feline Sterilised Cat Mature Adult : Croquettes pour chat adulte stérilisé à partir de 7 ans, apport calorique adapté et faible teneur en graisses. Teneur en minéraux adaptée pour des reins en bonne santé. * Croquettes Hill's Prescription Diet Feline c/d Multicare : Croquettes pour chat Hill's Prescription Diet Feline c/d Multicare au poulet, favorisent la santé des voies urinaires tout en réduisant les risques d'apparition de calculs rénaux. * Croquettes pour chat Hill's Prescription Diet Feline s/d : Croquettes Prescription Diet s/d Feline pour les chats souffrant des voies urinaires inférieures, recommandées par les vétérinaires : dissolvent les cristaux et les calculs de struvite. * Croquettes pour chat Pro Plan After Care : Croquettes Pro Plan After Care pour chat adulte castré ou stérilisé, à base de saumon et de thon, pour des voies urinaires saines et une bonne forme physique, renforcent les défenses naturelles. * Croquettes pour chat Royal Canin Sterilised 37 : Croquettes Royal Canin Sterilised 37 pour chats castrés et stérilisés ayant tendance à l'embonpoint. Apport énergétique contrôlé, avec de la L-carnitine, pour des voies urinaires saines. * Royal Canin Veterinary Diet - Urinary S/O Moderate Calorie : Croquettes pour chat adultes souffrant d'affections du bas de l'appareil urinaire. Permettent de dissoudre les calculs de struvite des chats adultes ayant tendance à l'embonpoint. * Royal Canin Veterinary Diet - Urinary S/O LP 34 : Croquettes pour chats de plus de 6 mois souffrant d'affections du bas de l'appareil urinaire. Permettent une dissolution des calculs de struvite et une gestion des récidives d'Urolithiase * Royal Canin Veterinary Diet - Urinary S/O High Dilution : Croquettes pour chat de plus de 6 mois, ayant une affection du bas de l'appareil urinaire. Permettent une dissolution rapide des calculs de struvite et une gestion des récidives d'Urolithiase. * Croquettes pour chat Specific Cat FCD Crystal Prevention : Croquettes pour chat spécifiquement recommandées par des vétérinaires pour réduire le risque de récidive de calculs de struvite chez les chats. (Il existe une version light mais je n'ai pas le nom) * Croquettes pour chat Virbac Vetcomplex Feline Renal : Croquettes pour chat complètes, avec une formule très digeste créée spécifiquement pour aider à prendre en charge les chats souffrants d'insuffisance rénale. * Croquettes pour chat Integra Protect Reins : Croquettes spécialement conçues pour les chats souffrant d'insuffisance rénale, teneur réduite en protéines et en phosphore, bonne appétence et digestion facile. * Croquettes pour chat Integra Protect Struvite : Croquettes réduisant les risques de formation de calculs de struvite, teneur réduite en magnésium, acides uriques, bonne appétence et digestion facile. * Croquettes pour chat Kattovit Urinary Low Magnesium (poulet ou thon) : Croquettes Kattovit Urinary Low Magnesium pour prévenir les calculs urinaires, réduisent le risque de réapparition de calculs de struvite, avec des substances acidifiantes, faible teneur en magnésium -

Comment nourrir son chat ?
Liliblue35 a répondu à un(e) sujet de Liliblue35 dans L'alimentation du chat
Conservation des croquettes : Comme toutes denrées alimentaires qui ne se conservent pas au frigo, pensez à mettre vos croquettes dans un endroit à l'abri de la chaleur et de l'humidité. Prenez l'habitude de bien refermer le sac soit avec la glissière déjà dessus, soit avec une pince. Il existe sinon des boites hermétiques de toutes les tailles vendues spécialement pour. On en trouve sur tous les bons sites de ventes de produits animaliers. Personnellement, comme je possède 3 chats et que j'achète des paquets de 8,5 kg parfois par deux, j'ai une grosse boîte en plastique sur roulettes. Elle possède deux ouvertures, une très grande pour y mettre les croquettes et une plus petite pour les prendre à chaque fois que j'en ai besoin. Un pelle était fourni avec. Elle est en plastique blanc. La plus petite ouverture est grise, la poignée de la grande l'est également et le pourtour est orné d'un bandeau vert clair. Il y a des photos de chats dessus. Donc en plus d'être pratique, elle est assez jolie. -

Comment nourrir son chat ?
Liliblue35 a répondu à un(e) sujet de Liliblue35 dans L'alimentation du chat
La taurine : est utilisée dans la prévention et le traitement de maladies cardiaques graves, appelées cardiomyopathies dilatées. Chez le chat, la taurine est un acide aminé indispensable. Elle est indispensable à la vision et à la fonction de production. Ses vertus protectrices vis-à-vis des radicaux libres en font également un anti-oxydant de choix dans la lutte contre le vieillissement. Elle peut être donnée en complément alimentaire si elle n'est pas contenue dans sa nourriture. -

Comment nourrir son chat ?
Liliblue35 a répondu à un(e) sujet de Liliblue35 dans L'alimentation du chat
L'alimentation ménagère : Le menu idéal devrait-être composé de : 50 % de viande maigre, d'abats ou de poisson 20 % de riz ou de céréales 20 % de légumes verts ou de carottes (cuits) 10 % de levure sèche, d'huile de table et d'un composé minéral vitaminé Des compléments peuvent également être utilisés afin de parfaire l'équilibre nutritionnel des repas dans le cadre d'une alimentation ménagère. L'alimentation industrielle: Nourriture humide La nourriture en boîte contient approximativement 80% d'eau. C’est la raison pour laquelle les chats qui reçoivent une alimentation de ce type ne ressentent pas le besoin de boire. Il est néanmoins nécessaire de laisser en permanence de l’eau propre et fraîche à disposition. La durée de conservation d’une boîte ouverte est faible surtout en période de fortes chaleurs, il en va de même pour la ration déposée dans l’écuelle de l’animal. Nourriture sèche L’intérêt de cette alimentation repose sur le fait que le chat est obligé de mâcher, ce qui contribue à améliorer la circulation au niveau des gencives et à réduire les dépôts de tartre sur les dents. Un apport d’eau est indispensable car les croquettes en contiennent peu (environ 10%) ce qui peut causer, à terme, des problèmes urinaires si le chat ne s’hydrate pas suffisamment. La conservation des croquettes étant bonne on peut les laisser à disposition entre les repas. Un mix aliments humides / aliments secs qui consiste à offrir, uniquement le temps du repas, une ration humide et à laisser en permanence des croquettes, permet de combiner les avantages respectifs des deux types d’alimentation. -
Nos différences : On ne nourrit pas un chat comme soit-même tout simplement parce que nous sommes omnivore et qu'un chat est carnivore. Les besoins du chat se compose de protéines pour 40% (10% pour un homme), 35% de lipides (30 pour l'homme) et de 25% de glucides (60 pour l'homme). Le chat possède environ 500 papilles gustatives, l'homme en possède 9 000. Par contre, le chat possède de 60 à 65 millions de cellules pour l'odorat, l'homme de 5 à 20 millions. Le chat n'a pas un sens grand gustatif, son choix alimentaire est donc plus olfactif. Lieu du repas : Il doit être loin de sa litière. Si vous possédez un chien, choisissez un lieu de préférence en hauteur. Ainsi, votre chat mangera au calme et votre chien, qui lui ne mange que deux repas pas jour évitera de se goinfrer avec une nourriture qui ne lui ai pas destiné. Personnellement, j'ai choisi la cuisine. Il faut lui laisser deux gamelles, au minimum, accessibles en permanence : > Une gamelle d'eau fraîche, voir plusieurs dans différentes pièces pour lui donner envie de boire. De préférence assez grande. Certains fabricants proposent maintenant des fontaines qui filtre l'eau et coule constamment, ce qui peut-être très attractif pour un chat qui boit peu. > Une gamelle de nourriture : un modèle stable et facile à nettoyer. Elle doit-être laissée en libre-service, comme déjà stipulé plus haut. Il existe aussi des distributeurs de croquettes qui permet d'aider un chat à se réguler et qui permet au sédentaire d'avoir l'impression de "chasser" sa nourriture, évitant ainsi la boulimie, voir le stress. Fréquence des repas : Les chats aiment grignoter de jour comme de nuit. Si vous avez choisi des croquettes, vous pouvez les donner à manger en libre-service. Le chat consomme la plupart du temps la quantité de nourriture dont il a besoin. Si vous rationnez votre chat, il aura tendance à la longue, de devenir boulimique ! L'alimentation : Évitez de trop varier l'alimentation de votre chat, cela évitera qu'il ne devienne trop difficile. Il existe un grand choix de nourriture pour chat préparé spécifiquement pour lui. Certaines sont bien adaptés au chat, d'autres augmentent les risques de calcules et problèmes urinaires, d'embonpoint, de tartre... Il faut nourrir son chat en fonction de son état. Demandez conseil à votre vétérinaire et bannissez (si vous pouvez) la nourriture des grandes surfaces. Personnellement, depuis la stérilisation de mes chats (à 6 mois), je suis passée à une nourriture spécifique pour chats stérilisés. Ils ont aujourd'hui deux ans et mangent toujours les mêmes croquettes sans s'en lasser ! Je leur offre de temps en temps un peu de sachet en gelée pour leur petit plaisir car cette nourriture est plus proche, en consistance, de la nourriture qu'ils pourraient trouver en extérieur. Les friandises : Notez que le chat ne sens pas du tout le goût sucré. Donc vos friandises, ne sont pas les siennes ! A éviter absolument car au contraire, elles peuvent devenir néfaste et provoquer des diarrhées. L'une des meilleures friandises pour votre compagnon serait le comprimé de levure de bière, qui de plus, lui apportera des vitamines et d'oligoéléments. Choisir de la levure avec le moins de magnésium possible car il peut être à l'origine de problèmes urinaires. Cela doit rester une friandise à offrir de temps à autres.
-

Circuit de jeu Catit Design Senses
Liliblue35 a répondu à un(e) sujet de Liliblue35 dans Chats : actualités, informations, divers
J'ai lu les avis sur un site de vente pour animaux et je pensais que cela aurait pu faire plaisir à Kiara et éventuellement à Sher Khan. Je ne me suis pas trompée, Kiara adore ce jeu et Sher Khan y joue également un peu quand je lui donne l'envie... Voici une petite photo de derrière les fagots, mais j'en ai d'autres. N'hésitez pas à partager les vôtres ! D'ailleurs, la miss y joue actuellement, c'est marrant !